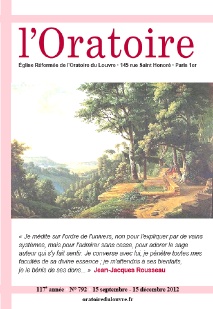/
/
|
Bulletins de l'Oratoire > N°792 de septembre 2012
Dossier :
Rousseau, une lumière protestante
Du contrat réformé
Philippe Gaudin est philosophe, après avoir été enseignant, il est maintenant spécialiste de l’enseignement du « fait religieux » et des systèmes de pensées.
Rousseau fait partie de ces monstres sacrés bien connus de tout le monde et donc mal connus. Nous avons tous une ou des « images » de lui. Le grand homme qui vous accueille au Panthéon, le grand naïf qui croyait que le sauvage était bon, l’inspirateur de la Révolution, le grand théoricien de l’éducation qui abandonna ses enfants, le protestant qui devint catholique plus d’une fois pour revenir au protestantisme, le marcheur amoureux de la nature qui se sentait persécuté par tous etc. La force de ces clichés est sans doute le signe d’une personnalité très riche et complexe dont nous allons malgré tout essayer de montrer la cohérence.
Rousseau fut théologien, moraliste, penseur de l’éducation et de la politique. C’est parce qu’il fut tout cela qu’il fut philosophe, mais là encore cela est sans doute resté masqué parce qu’il est un des plus grands prosateurs de la langue française et que la profondeur de la pensée de Rousseau fut éclipsée par le talent des confessions de Jean-Jacques.
Rousseau fut Théologien. Non pas tant théologien des religions statutaires et de leurs dogmes que théologien naturel. « Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l’a fait parler à sa mode et lui a fait dire ce qu’il a voulu. Si l’on n’eût écouté que ce que Dieu dit au cœur de l’homme, il n’y aurait jamais eu qu’une religion sur terre »1. C’est donc naturellement que Dieu parle à l’Homme comme au vicaire savoyard. Sa voie d’accès est double, intérieure et extérieure : dans l’intimité secrète du sentiment et dans le contact et la contemplation de la nature. Dieu a laissé comme une marque : l’état de Nature en nous et l’Homme absolument sain, en deçà du bien et du mal, qui est ce fameux « sauvage » qu’il faut être capable de retrouver en soi. Voilà le cœur du malentendu sur la pensée de Rousseau : celui-ci parle de la Nature au sens de ce qui est sorti des mains de Dieu et pas du tout du tout de ce qui existe autour de nous sans intervention aucune de l’art. La Nature est ce que Dieu a fait et la nature est ce dans quoi l’homme est tombé. L’Homme sauvage ou naturel n’est pas l’homme livré à lui-même et sans éducation. Il est certain que Rousseau, à l’instar de Montaigne, a été impressionné par des récits de voyageurs rapportant les mœurs bien aussi vertueuses que les nôtres de ceux que l’on prétend « sauvages ». Mais il faut absolument renoncer à une lecture historique du sauvage comme étant l’homme qui nous aurait précédé et qu’il faudrait retrouver au titre de son antériorité comme on voudrait, coûte que coûte, retrouver un âge d’or ou un paradis perdu. Le sauvage n’est pas une donnée empirique mais essentielle et sa dignité tient à son intériorité que découvre le sentiment d’un cœur pur révélé par une conscience qui s’interroge elle-même. Et des générations entières de lecteurs pressés de croire que Rousseau prêche pour un « retour à la nature » : « Quoi donc ? Faut-il détruire le tien et le mien, et retourner vivre dans les forêts avec les ours ? Conséquence à la manière de mes adversaires, que j’aime autant prévenir que de leur laisser la honte de tirer.»2
Rousseau fut moraliste. En effet la conduite humaine se comprend à partir de cet Homme essentiel qui est « bon » si l’on veut, mais uniquement au sens où son âme n’est soumise qu’à de saines passions dont les premières sont l’amour de soi et la pitié : « Méditant sur les premières et plus simples opérations de l’Ame humaine, j’y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l’un nous intéresse ardemment à notre bien être et à la conservation de nous-mêmes, et l’autre nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables »3. La chute a lieu quand on passe de l’amour de soi à l’amour propre dont l’empire aura tôt fait d’étouffer la pitié et d’introduire la cruauté dans le monde. « L’amour de soi qui ne regarde qu’à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits ; mais l’amour-propre qui se compare, n’est jamais content et ne saurait l’être, parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux ; ce qui est impossible. ». L’homme est l’animal qui a, petit à petit, établit sa suprématie sur les autres animaux. Sa raison est à la fois la cause et la conséquence de cette suprématie. Comparer c’est raisonner et réciproquement. Se comparer sans cesse, ne vaut pas que vis-à-vis de l’animal mais vis-à-vis d’autrui. Le moteur de la vie sociale est cette comparaison/compétition permanente qui est à la fois ce qui engendre les progrès dans tous les domaines et ce petit enfer psychologique que tous les hommes connaissent bien et que l’on peut appeler le péché. La comparaison engendre l’amour de préférence et « De ces premières préférences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie…c’est ainsi que chacun punissant le mépris qu’on lui avait témoigné d’une manière proportionnée au cas qu’il faisait de lui-même, les vengeances devinrent terribles, les hommes sanguinaires et cruels. ». L’amour de soi entraîne la bienveillance à l’égard des autres, tandis que l’amour-propre entraîne la haine de soi (parce qu’on n’est jamais à la hauteur de celui que l’on voudrait être) et des autres (parce qu’ils peuvent avoir le mauvais goût d’être plus talentueux que soi). La morale de Rousseau est donc une morale de la simplicité qui ne prétend pas pouvoir annuler la possibilité de la chute mais au moins en brider les effets. La haine du luxe était telle chez lui qu’elle le rendait incapable de porter un jugement esthétique sur le château de Versailles, comme le faisait remarquer Kant avec une pointe d’humour ! Nos modernes promoteurs de la « sobriété heureuse » peuvent être considérés à bon droit comme des enfants de notre philosophe.
Rousseau fut un penseur de l’éducation. Les conseilleurs ne sont pas les meilleurs, certes, mais cela n’implique pas que les conseils soient dépourvus d’intérêt ! La morale de Rousseau n’est pas que négative (limiter les dégâts de l’amour-propre), il s’agit de préparer positivement l’avenir. Pour cela, le moyen par excellence est l’éducation. En cela ce n’est certes pas une découverte et les philosophes de l’antiquité n’ont cessé de penser la solidarité profonde entre métaphysique, éducation et politique, au moins pour les hommes libres. Dans son Emile, il relate les mille ruses, attentions et artifices pour que l’éducation, cet art achevé, retourne à la nature. Mais la nature dont il est question ici est aux antipodes d’un état figé et stationnaire, elle est au contraire un dynamisme continuel, elle est ce qui fait de l’homme l’être perfectible par excellence. On sent bien qu’au siècle de Rousseau et en Europe, on commence à sortir de cet ordre des choses qui prévaut encore dans beaucoup de pays du monde : il y a des enfants qui jouent et, dès la puberté, des adultes qui se mettent au travail et à la procréation. Rousseau éducateur est une réponse à cette invention récente dans l’histoire : l’adolescence. Le développement des métiers, des sciences, des arts et des lettres appelle un temps d’éducation plus long pour de plus en plus d’enfants. Mais, contrairement à l’idée simpliste que l’on se fait des philosophes des Lumières, Rousseau, dans le premier texte qui l’a rendu célèbre, a répondu négativement à la question posée par l’académie de Dijon : « Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs ». Tout ce qui nous comble au-delà des sains besoins nous fait tomber dans le raffinement et dans la décadence. Il faudra redoubler de soins dans l’art de l’éducation si l’on ne veut pas trop s’éloigner de la nature et que notre Emile ne connaisse qu’un développement harmonieux de ses facultés naturelles…
Rousseau fut un penseur politique. Il écrivit d’ailleurs son Contrat social en même temps que l’Emile. Traiter séparément de morale et de politique s’est s’exposer à ne rien comprendre aux deux. Le contrat social, le pacte qui scelle le fondement du droit politique, n’est pas lui non plus un moment dans l’histoire, c’est une fiction pour comprendre ce qui rend légitime l’obéissance à la loi. C’est parce que les droits du citoyen sont conçus pour respecter l’Homme essentiel que la cité pourra réunir les conditions dans lesquelles les hommes pourront, enfin, conformément à leur nature profonde, devenir humains. « L’homme est né libre et partout il est dans les fers », ainsi s’ouvre le Contrat. Mais au nom de quoi décréter que les choses sont autres que ce qu’elles sont, que les hommes ne sont pas ce qu’ils sont, c'est-à-dire rien d’autre qu’oppresseurs et opprimés ? Ce tour de pensée peut paraître bizarre et audacieux et pourtant c’est celui là même que l’on trouvera dans ce texte qui est au cœur de notre droit aujourd’hui encore : la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ces droits sont déclarés alors même qu’ils sont en fait institués : ils sont une nouveauté bouleversante dans l’histoire, mais n’ont de force que parce qu’ils sont pensés comme naturels, inaliénables et sacrés depuis toujours et depuis toujours oubliés et méprisés. On retrouve cette philosophie de la nature humaine qui ne nous renvoie pas au passé mais nous projette dans l’avenir : l’humanité de l’homme est en puissance de devenir, une promesse à tenir et non une nostalgie.
Que faut-il retenir de tout cela et qu’est-ce qui fait de Rousseau notre contemporain ? Il est avant tout un penseur chrétien, ce que la France catholique et révolutionnaire a tant de mal à comprendre. Mais un penseur qui réécrit le récit biblique à sa manière, qui laïcise la Genèse si l’on veut et nous la fait lire comme on aurait toujours dû la lire, c'est-à-dire une histoire qui n’est pas historique. Il est un penseur de la chute, non de celle qui aurait eu lieu un jour il y a longtemps, mais qui a lieu et qui aura lieu tous les jours, quand l’homme sort de lui-même, oublie l’amour de soi et la pitié pour se laisser happer par la spirale de l’amour-propre. Sa peinture de la société et de l’homme tels qu’on peut les voir est très sombre et pourrait ainsi le rapprocher d’un christianisme doloriste où la vie ne serait faite que pour expier la faute d’avoir quitté Dieu et pour imiter un Christ qui ne serait venu sur terre que dans le but de payer par le sang le prix de notre rédemption. Or la conséquence qu’en tire Rousseau est aux antipodes de cet enfermement sadique et de ce passéisme. La chute n’est pas un événement historique mais symbolique de la condition humaine, par contre, c’est dans l’histoire que l’Homme trouvera sa rédemption par une meilleure éducation et par l’émancipation politique. Rousseau est un théologien du sentiment et un philosophe qui en appelle à la raison pour que la loi ne soit rien d’autre que l’expression de la volonté générale. Dieu est au commencement bien sûr comme puissance créatrice, mais il ne se réalise qu’à la fin. De manière analogue l’homme peut s’humaniser progressivement. En ce sens, on peut considérer à bon droit Rousseau comme un père du christianisme libéral. Aucun optimisme naïf de sa part, puisque le développement de notre puissance est aussi celui de notre corruption et pourtant son progressisme est résolu.
Enfin, puisque selon la belle formule de Nietzsche, toute grande philosophie n’est que la confession personnelle de son auteur, que peut-on apprendre de Jean-Jacques ? Que l’on peut faire toutes sortes de petits métiers, être artisan, précepteur, musicien, écrivain ; que l’on peut traverser les conditions sociales dans la fréquentation des plus humbles comme celle des hautes sphères ; que l’on peut être un grand amoureux et un grand théoricien du droit ; que l’on peut, dans les terribles limites et les nombreux défauts d’un individu, tenter de devenir humain grâce aux ressources que Dieu donne au travers de la nature et de son Évangile.
par Philippe Gaudin
Notes :
- Emile, Livre IV.
- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, note 9 p. 207
- Préface au Discours sur l’origine
Jean-Jacques Rousseau était-il protestant ?
 Bernard Cottret est auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur les civilisations anglo-saxonnes, la Réforme, l’histoire du XVIIIe, la philosophie dont un sur Jean-Jacques Rousseau… Bernard Cottret est auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur les civilisations anglo-saxonnes, la Réforme, l’histoire du XVIIIe, la philosophie dont un sur Jean-Jacques Rousseau…
Né à Genève le mardi 28 juin 1712 dans une famille issue du « premier Refuge », celui du XVIe siècle, baptisé à Saint-Pierre le 4 juillet, familier des psaumes et jusqu’au bout de sa vie grand lecteur de la Bible, Jean-Jacques Rousseau ne pouvait qu’être protestant. Protestantisme sociologique, nous dira-t-on. « Jean-Jacques Rousseau, qui montra quelques talents, surtout en musique, était un jean-fesse qui prétendait tirer sa morale de la nature et qui la tirait en réalité des principes de Calvin », fera dire Anatole France à l’un de ses personnages. A l’adolescence, Jean-Jacques s’enfuit, abjure l'" hérésie " calviniste, et reçoit à Turin les " accessoires du baptême " catholique. Son idylle quasi incestueuse avec Madame de Warens, autre transfuge, devenue pour l’orphelin une authentique « Maman », est à l’unisson d’une dévotion, imprégnée des enseignements de François de Sales, ce bon "Monsieur de Genève", chargé au siècle précédent d’arracher les âmes protestantes à la perdition. Rousseau a été catholique, il a été catholique convaincu avant de revenir bien plus tard, dans les années 1750, à la religion de ses pères.
Le retour de l’enfant prodigue
Après une vie d’errance entre Chambéry, Paris et Venise, Rousseau entame en 1754 son retour dans sa patrie. Dans sa correspondance avec Voltaire qui exécrera toujours ce fils d’artisan, Rousseau s'était proclamé par provocation " citoyen de Genève ". Citoyen de Genève il était, citoyen de Genève il redevient. Et pour cela il se refait protestant. Ou du moins il abjure le catholicisme, mais, vaguement honteux, il l’abjure in abstentia, en laissant à un pasteur complaisant le soin de présenter son dossier devant le consistoire de Genève en date du 25 juillet 1754. " Le sieur Jean-Jacques Rousseau, citoyen, ayant été conduit en France dès son bas âge, y avait été élevé dans la religion romaine et l'avait professée pendant plusieurs années ".
Fariboles que tout cela. Rousseau était allé en Savoie de son plein gré et c’est en toute connaissance de cause qu’il avait épousé la religion romaine. Par contre la suite du témoignage est plus authentique : " Dès qu'il a été éclairé et reconnu les erreurs /de l’Eglise romaine/, il n'en a plus continué les actes, qu'au contraire il a dès lors fréquenté assidûment les assemblées de dévotion à l'hôtel de Monsieur l'ambassadeur de Hollande à Paris, et s'est déclaré hautement de la religion protestante ". Et ce raccourci final : " C'est pour confirmer ces sentiments qu'il a pris la résolution de venir dans sa patrie pour faire abjuration et rentrer dans le sein de notre Église".
L'argument patriotique semble avoir été déterminant dans cette évolution spirituelle. Mais il faut y ajouter l’exaspération liée aux querelles internes au catholicisme français. Désireux d’en finir avec les jansénistes, Monseigneur Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, avait imposé la pratique des refus de sacrements. Qui n’avait pas été confessé par un prêtre jugé acceptable ne pouvait recevoir les sacrements de l’Église. Et donc risquait la damnation en mourant sans absolution de ses fautes et sans extrême onction.
Ce chantage à l’au-delà scandalisa Rousseau. Il renoua avec l’indignation de Luther face aux indulgences. Non, le salut n’était ni une marchandise ni un moyen de pression aux mains du clergé. Mais s’il revint à la religion de ses pères, s’il ne manqua pas de participer publiquement à la sainte Cène quelques années plus tard encourant les sarcasmes des philosophes, Jean-Jacques professa désormais en son âge mûr une variante hétérodoxe du protestantisme réformé. Il exprima quelques réserves sur la validité ou la cohérence de l’Ecriture : " Nous ne respectons pas précisément ce Livre sacré comme Livre, mais comme la parole et la vie de Jésus-Christ. Le caractère de vérité, de sagesse et de sainteté qui s'y trouve nous apprend que cette histoire n'a pas été essentiellement altérée ; mais il n'est pas démontré pour nous qu'elle ne l'ait point été du tout. Qui sait si les choses que nous n'y comprenons pas ne sont point des fautes glissées dans le texte? Qui sait si des disciples si fort inférieurs à leur maître l'ont bien compris et bien rendu partout? "
Jésus ignoré ? Jésus oublié ? Jésus falsifié ? Comment fonder selon Rousseau une authentique critique des textes, attentive aux aléas de la transmission ?
Jacques ou Paul ?
C’est dans les œuvres que l’on trouvera les éléments d’une confession de foi profondément originale. En tout iconoclaste. " Calvin, sans doute, était un grand homme, mais enfin c'était un homme, et, qui pis est, un théologien ", écrira-t-il. Mais surtout il professera toujours un certain scepticisme envers le christianisme de Paul et la justification par la foi. " Monseigneur, je suis chrétien, écrira-t-il à Monseigneur de Beaumont, et sincèrement chrétien, selon la doctrine de l’évangile. Je suis chrétien, non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Mon maître a peu subtilisé sur le dogme, et beaucoup insisté sur les devoirs ; il prescrivait moins d’articles de foi que de bonnes œuvres ; il n’ordonnait de croire que ce qui était nécessaire pour être bon ; quand il résumait la loi et les prophètes, c’était bien plus dans des actes de vertu que dans des formules de croyance, et il m’a dit par lui-même et par ses apôtres, que celui qui aime son frère a accompli la loi ». Et ce jugement sans appel : " Moi, de mon côté, très convaincu des vérités essentielles au christianisme, lesquelles servent de fondement à toute bonne morale, cherchant au surplus à nourrir mon cœur de l’esprit de l’évangile sans tourmenter ma raison de ce qui m’y paraît obscur, persuadé que quiconque aime Dieu par-dessus toute chose, et son prochain comme soi-même, est un vrai chrétien, je m’efforce de l’être, laissant à part toutes ces subtilités de doctrine, tous ces importants galimatias dont les pharisiens embrouillent nos devoirs et offusquent notre foi, et mettant, avec saint Paul, la foi même au-dessous de la charité ".
Visiblement –et c’est là qu’il se distingue -, Rousseau préfère Jacques, frère du Seigneur, et son « épître de paille », à l’apôtre Paul et à son épître aux Romains. Legs du catholicisme de ses vertes années peut-être, une religion des œuvres se substitue chez lui à la justification par la foi. Un christianisme ou un protestantisme non-pauliniens sont-ils envisageables ? Voire même souhaitables ? Telles sont les questions en un sens insolubles que Jean-Jacques nous pose inlassablement depuis deux siècles et demi.
par Bernard Cottret
Rousseau, nature et histoire
 France Farago est philosophe, et sait fort bien mettre un petit peu à ma hauteur des pensées philosophiques qui me seraient inaccessibles. France Farago est philosophe, et sait fort bien mettre un petit peu à ma hauteur des pensées philosophiques qui me seraient inaccessibles.
« Jamais peuple n'a subsisté ni ne subsistera sans religion » écrivait Rousseau dans son Contrat social. Au cœur du siècle des Lumières françaises, Rousseau apparaît comme une exception. Alors que tous les « philosophes » font l'éloge du progrès, il affiche à son égard plus qu'une simple méfiance. Alors que tous les « philosophes » célèbrent la raison que les hébertistes athées diviniseront pendant la Révolution, Rousseau, comme Pascal au siècle précédent, ne croit pas que la raison soit, chez l'homme, la faculté des principes. Comme Pascal, il pense que les passions risquent à tout moment de la corrompre. Alors que les « philosophes » sont athées, au mieux déistes, pourchassant le christianisme assimilé à une honteuse superstition, Rousseau est théiste, revendique son allégeance au christianisme et clame sa foi en un Dieu bon, Etre Suprême, auteur de la nature à laquelle il a conféré la bonté. La question centrale qu'il se pose est la suivante : comment l'homme, sorti des mains de la nature doté de cette bonté, est-il devenu ce que dévoile le spectacle de l'histoire et que sondent les auteurs de maximes comme La Rochefoucauld ou Chamfort en faisant la satire de l'homme actuel? Le développement des sciences occulte la pauvreté du savoir de l'homme sur lui-même : « La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l'homme et j'ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes » (OC III, p.122). Ce constat amène Rousseau à reprendre l'injonction inscrite au fronton du temple d'Apollon à Delphes que Socrate avait fait sienne. Le « Connais-toi toi-même» est une invitation à chercher ce qui cache l'homme à lui-même pour l'amener à se connaître tel qu'il est.
Ce « tel qu'il est », faisant abstraction de ce qu'il paraît, voilà ce qu'il faut d'abord lire sous le mot « nature » dans la pensée de Rousseau. Le conseil socratique suppose une ignorance de soi, une difficulté de se connaître que Rousseau explique par l'histoire : l'homme est devenu autre qu'il n'est. Le devenir de l'homme a été infidèle à l'être de l'homme. Son histoire a altéré sa nature en déposant sur elle ses alluvions l' enfouissant au point de la rendre méconnaissable. « L'homme de l'homme » s'est substitué à « l'homme de la nature » au point d'aboutir à ce paradoxe cruel : « tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et c'est en un sens à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître » (OC III, p.122-123). Rousseau serait certainement effaré aujourd'hui en voyant les processus d'objectivation de l'homme qui sont à l'oeuvre dans les « sciences humaines »...
Cet enfouissement a amené Rousseau à forger la fiction de l'état de nature pour écarter tous les faits de l'histoire. L'état de nature est extra-moral et extra-historique. S'il récuse le dogme du péché originel, c'est cependant sous la forme des catégories de « l'avant » et de « l'après » qu'il décrit l'homme en sa nature supposée. Comme le théologien, Rousseau se sert d' un état antérieur à l'histoire, situé en -deçà des faits, hypothèse purement méthodologique, pour faire l'analyse de l'homme historique. C'est une reconstruction imaginaire qui se substitue au mythe biblique auquel cependant il se réfère explicitement dans la note 9 du Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes pour rappeler que même là, le gardien du paradis muni d'une épée de feu empêche qu'on y revienne. L'état de nature est un état auquel l'humanité ne doit pas revenir. C'est donc au cœur de l'histoire qu'il nous faut retrouver la bonté naturelle. Là où le christianisme traditionnel opposait la nature blessée par le péché et la grâce restauratrice, Rousseau, qui exclut la surnature des théologiens, oppose la nature créée par Dieu à l'histoire qui l'a dénaturée. Dans sa pensée, la nature se substitue à la grâce et l'histoire à la nature. Dans les deux cas, il s'agit de réparer un désordre. « En créant l'homme, dit Saint-Preux de l'Etre Suprême, il l'a doué de toutes les facultés nécessaires pour ce qu'il exigeait de lui...Il nous a donné la raison pour connaître ce qui est bien, la conscience pour l'aimer, et la liberté pour le choisir. C'est dans ces dons sublimes que consiste la grâce divine » (Nouvelle Héloïse, V, Lettre 7, p.683). Des deux côtés, il y a une innocence à retrouver, un « vieil homme » à tuer.
par France Farago
La bonté originelle de l’homme ?
 Laurent Gagnebin est théologien et aussi un grand spécialiste et amateur de littérature. Laurent Gagnebin est théologien et aussi un grand spécialiste et amateur de littérature.
La thèse de Rousseau selon laquelle l’homme est né bon a-t-elle été bien comprise, au moins dans ses intentions ? On a vu là en Rousseau un rêveur impénitent et un idéaliste naïf. Un tel jugement paraît bien imprudent quand on sait la force et la finesse de sa pensée. S’il affirme que l’homme est né bon, c’est qu’il a, après une réflexion approfondie, de solides raisons de le faire.
L’histoire humaine dont il retrace les étapes dans ses premiers Discours est faite sur le mode de la fiction et du mythe. Dans le Discours sur l’origine de l’inégalité, il le dit clairement en parlant d’une « histoire hypothétique » avec laquelle il a « hasardé quelques conjectures », soulignant alors le « peu de vraisemblance » des événements évoqués, allant même jusqu’à dire que cet état originel « n’a peut-être point existé ». La bonté originelle de l’homme est en effet pour Rousseau un postulat, par définition par conséquent indémontrable, mais un postulat indispensable. L’affirmation selon laquelle l’homme est né bon est une proposition nécessairement requise, une hypothèse que les fins que l’on vise rendent impérieuse.
Qu’est-ce que cela signifie ? Rousseau vise une réalité éthique. C’est elle qui a posteriori justifie l’a priori concernant la bonté originelle de l’homme. On ne doit pas interpréter Rousseau à ce sujet dans l’ordre de la causalité et de l’histoire, mais dans celui de la finalité et de l’éthique. Son postulat est vrai parce qu’il conduit à une vérité et non pas parce qu’il en proviendrait : « … sur les principes que je viens d’établir, on ne saurait former aucun autre système qui ne me fournisse les mêmes résultats, et dont je puisse tirer les mêmes conclusions. »
Dire que l’homme est né bon, cela seul permet en effet de faire appel à la responsabilité active de l’être humain, là où il cherche toujours à plaider non coupable se réfugiant ainsi dans la passivité paresseuse d’un « je n’y peux rien changer » et d’un « ce n’est pas ma faute ». Pour Rousseau, la « perfectibilité » est possible. La responsabilité fait appel à notre liberté, à notre action créatrice : « … je montrais aux hommes comment ils faisaient leurs malheurs eux-mêmes et par conséquent comment ils pouvaient les éviter. » (Lettre à Voltaire) La plupart de nos maux sont de notre fait. Rousseau distingue assurément le « mal moral » du « mal physique ». Le second, qui frappe même la matière, ne nous est certes pas imputable, encore que nous fassions beaucoup, selon Rousseau, pour l’empirer, l’aggraver. Il a certainement sous-estimé ce mal physique et, par là, un aspect décisif du tragique de la condition humaine telle que nous la comprenons aujourd’hui grâce, largement, aux philosophies de l’existence.
Ce qui est certain, c’est que Rousseau rejette le fatalisme facile de théories philosophiques et théologiques qui, pour excuser l’homme, cherchent dans ses origines lointaines la cause de ses maux et, ce faisant, le conduisent à une éthique de la démission et de la résignation. C’est là où l’on perçoit son adhésion à un réalisme et non pas, comme on le croit communément, à un idéalisme et à des chimères. En disant que l’homme est né bon, je ne cherche plus l’origine du mal en une source divine, quel que soit son nom : « Celui qui peut tout ne peut vouloir que ce qui est bien » (Émile). Je ne la cherche pas non plus dans la nature humaine sans cesse incriminée via la doctrine bien commode du péché originel, doctrine que Rousseau a souvent, résolument et longuement combattue. Il parle avec ironie de ce péché « pour lequel nous sommes punis très justement des fautes que nous n’avons pas commises » ! (Mémoire à M. de Mably)
Non, le postulat de la bonté originelle de l’homme signifie et implique un combat réaliste et créateur contre toutes les doctrines qui, réduisant l’homme au néant de sa condition pécheresse, le démobilisent en le soumettant pieds et poings liés à une nature humaine insurmontable et à une divinité, source seule véritablement responsable de nos maux. L’homme naît bon ? Oui, si devant le spectacle du mal, il se veut un acteur responsable. Jean Starobinski, un des meilleurs connaisseurs de Rousseau, a parfaitement saisi son entreprise à cet égard novatrice : « Ainsi par un transfert de responsabilité dont on n’a peut-être pas assez souligné l’importance, Rousseau présente comme une œuvre humaine ce que la tradition définissait comme un don originel de la nature ou de Dieu. » (J.-J. ROUSSEAU, Œuvres complètes, La Pléiade, III, p. LVII)
par Laurent Gagnebin
|
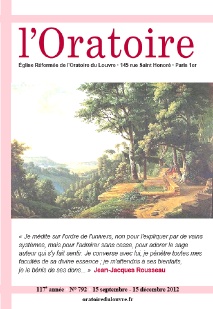
|
 Bernard Cottret est auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur les civilisations anglo-saxonnes, la Réforme, l’histoire du XVIIIe, la philosophie dont un sur Jean-Jacques Rousseau…
Bernard Cottret est auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur les civilisations anglo-saxonnes, la Réforme, l’histoire du XVIIIe, la philosophie dont un sur Jean-Jacques Rousseau… France Farago est philosophe, et sait fort bien mettre un petit peu à ma hauteur des pensées philosophiques qui me seraient inaccessibles.
France Farago est philosophe, et sait fort bien mettre un petit peu à ma hauteur des pensées philosophiques qui me seraient inaccessibles. Laurent Gagnebin est théologien et aussi un grand spécialiste et amateur de littérature.
Laurent Gagnebin est théologien et aussi un grand spécialiste et amateur de littérature.