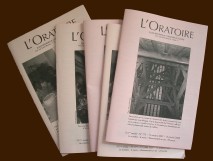Judaïsme et Christianisme :
de l’enseignement du mépris à l’enseignement
de l’estime
La séparation entre
l’Eglise et la synagogue au 1er siècle de notre ère
fut douloureuse et polémique, comme l’attestent le
livre des Actes ainsi que les Evangiles, rédigés
à partir de l’an 70. Les relations difficiles entre
juifs et chrétiens, aboutirent à la persécution
des premiers par les seconds, à partir du moment où
le christianisme devint religion officielle. Pendant des siècles,
ces persécutions se sont largement nourries de l’antijudaïsme
professé par les Eglises et les théologiens, dénonçant
le peuple juif dans son ensemble comme peuple déicide et
lisant ses malheurs et son errance comme un châtiment divin
destiné à éclairer la vérité
chrétienne.
L’impact décisif des Lumières
Blaise Pascal écrivait encore au 17ème siècle
: « C’est une chose étonnante et digne d’une
étrange attention, de voir ce peuple juif subsister depuis
tant d’années et de le voir toujours misérable
: étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ
et qu’il subsiste pour le prouver, et qu’il soit misérable,
puisqu’ils l’ont crucifié : et quoiqu’il soit
contraire d’être misérable et de subsister, il
subsiste néanmoins toujours, malgré sa misère...
».
Même si cette histoire tragique a connu des exceptions et
que des amitiés, du travail en commun, du voisinage ont également
lié des juifs et des chrétiens, il a fallu attendre
l’impact des Lumières et la mise en valeur de la vertu
de tolérance pour qu’un premier pas, décisif,
soit franchi sur le plan social et politique et que les juifs trouvent
dans la société une place autre que le ghetto et le
mépris.
En 1941, une position courageuse
En France, le judaïsme s’est officiellement organisé
en même temps que le protestantisme, au XIXème siècle,
à partir du moment où la liberté de culte a
été reconnue. Et même l’affaire Dreyfus,
au tournant du XXème siècle, ne devait pas empêcher
de significatives vagues d’immigration juive de Russie et de
Pologne, non seulement pour fuir les pogroms qui s’y déroulaient,
mais avec l’idée qu’un pays, où une partie
de l’opinion se levait pour défendre un juif, était
un pays merveilleux.
L’histoire a, néanmoins, montré que le glissement
d’un antijudaisme plutôt religieux à un antisémitisme
plutôt social allait déboucher sur un paroxysme de
persécution avec la solution finale mise en œuvre par
Hitler. Ceux qui s’opposèrent aux lois de Vichy en France
et aidèrent les juifs menacés le firent pour des raisons
d’humanité, d’amitié, de solidarité
avec les victimes, y mêlant parfois aussi des raisons théologiques.
Dès 1941, par exemple, les thèses de Pomeyrol, rédigées
par quelques pasteurs et fidèles, déclaraient à
l’intention des Eglises de la Réforme « Fondée
sur la Bible, l’Eglise reconnaît en Israël le peuple
que Dieu a élu pour donner un Sauveur au monde et pour être
au milieu des nations un témoin permanent du mystère
de sa fidélité. C’est pourquoi, tout en reconnaissant
que l’Etat se trouve devant un problème auquel il est
tenu de donner une solution, elle élève une protestation
solennelle contre tout statut rejetant les Juifs hors des communautés
humaines.» (thèse n°7).
L’ouverture de Vatican II
C’est cette dimension théologique qui sera reprise
à nouveau frais après la guerre et la découverte
de la Shoah. En 1947, l’Amitié judéo-chrétienne
ouvrit une époque de connaissance mutuelle et de réflexion
en commun en se donnant pour tâche de « travailler à
réparer les iniquités dont les juifs et le judaïsme
ont été victimes depuis des siècles, à
en éviter le retour et à combattre l’antisémitisme
et l’antijudaïsme dans toutes leurs manifestations »,
tout en excluant « de son activité toute tendance au
syncrétisme et toute espèce de prosélytisme
».
Par ailleurs, ’Eglise catholique inaugura un changement profond
dans ses relations avec le judaïsme à partir du Concile
Vatican II. L’article IV du document « Noestra Aetate
» opéra une rupture radicale avec les thèses
séculaires de l’antijudaïsme en reconnaissant au
peuple juif une vocation toujours actuelle. Pour l’affirmer,
il s’appuyait sur cette parole de Paul dans l’épître
aux Romains : « Les dons gratuits et l’appel de Dieu
sont irrévocables. »(Ro.11,29). Les implications de
cette ouverture allaient être importantes : non seulement
l’affirmation des racines juives du christianisme mais aussi
le lien vivant, actuel et privilégié qu’il doit
entretenir avec son « frère aîné ».
Le travail accompli par les protestants
Côté protestant, un grand travail a été
également accompli depuis la fin de la seconde guerre mondiale
dans les différents pays d’Europe. Entre 1996 et 2000,
la communion ecclésiale de Leuenberg, qui réunit depuis
1973 les Eglises luthériennes et réformées
d’Europe, a élaboré un document « Eglise
et Israël », dans lequel sont reconnues « les interprétations
fautives de certaines affirmations et traditions bibliques »,
responsables pour une grande part de la malveillance des chrétiens
à l’égard du peuple d’Israël.
Ce document propose tout un chantier théologique pour repenser
les relations entre judaïsme et christianisme à partir
de la reconnaissance du judaïsme comme voie de salut, fondée
sur l’Alliance irrévocable de Dieu avec son peuple.
Une autre affirmation essentielle est que la relation du christianisme
au judaïsme va bien au-delà du dialogue avec d’autres
religions, car elle concerne le christianisme de l’intérieur.
Elle est nécessaire à la compréhension que
l’Eglise a d’elle-même. Juifs et chrétiens
sont donc fortement encouragés les uns et les autres à
la connaissance mutuelle et au dialogue.
Ce document européen n’est pas encore très
connu de nos Eglises. C’est pourquoi un petit groupe de pasteurs
a cru bon d’organiser un colloque pour en expliquer les apports
et poursuivre le travail de réflexion. Ce colloque aura lieu
du jeudi 21 septembre à 14h au samedi midi 23 septembre.
Y interviendront le Professeur Joosten de Strasbourg, le Professeur
Tomson de Bruxelles, le Pasteur Massini, responsable de la Commission
« Chrétiens et Juifs à la Fédération
protestante de France, et le Rabbin Rivon Krygier. Le Cardinal Lustiger
apportera sa contribution, et une grande conférence publique
aura lieu à l’Oratoire avec le Professeur Elisabeth
Parmentier de Strasbourg et le Rabbin Krygier. Evénement
à ne pas rater !
Florence Taubmann