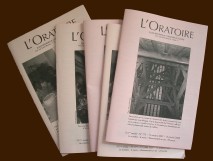|
/
/
|
L’élection,
une responsabilité grave et magnifique
Dans une année d’élections
le mot candidat est sur toutes les lèvres. Il vient du latin
candidus : candide, qui indique non un trait de caractère
mais la toge blanche revêtue par celui qui briguait une fonction
dans la cité romaine. Quant au mot élection, son étymologie
nous ramène à l’idée de choix, du latin
classique eligere : choisir, en passant par le latin populaire ex
legere : cueillir, choisir, rassembler, qui a également donné
notre beau verbe lire, c’est-à-dire assembler les lettres
par les yeux, ou encore cueillir, recevoir comme étant écrit.
Dès le XIIème siècle apparaît pour élire
le sens de nommer quelqu’un à une fonction ou à
une dignité par voix de suffrage, lequel tardera encore quelques
siècles à devenir universel et à nous permettre
de nous rendre régulièrement aux urnes.
L’acte inaugural : un appel et une libération
Cette idée de choix, puis de responsabilité, se
retrouve quand nous interrogeons la Bible sur le thème de
l’élection. Le verbe hébreu bahar, qui signifie
initialement jeter un regard rapide indique aussi bien le choix
au sens usuel du terme que le choix que Dieu porte sur un peuple.
Choix libre, qui peut sembler arbitraire car il ne s’appuie
sur aucun critère de qualité ou de mérite,
mais sur la seule inclination de Dieu pour ce peuple. En revanche,
cet arbitraire disparaît avec les termes forts d’alliance,
de promesse et de commandements, et donc les thèmes de l’engagement,
de la responsabilité et de la fidélité. Le
peuple qui a été appelé par le choix libre
et souverain de Dieu se trouve tenu de lui répondre et de
choisir entre son Dieu et les idoles. Mais ce choix survient au terme d’un processus en deux temps
: celui de la marche et celui de l’écoute. L’acte
inaugural de l’élection est un appel, si l’on songe
à Abraham, et une libération si l’on considère
Moïse et le peuple hébreu en Egypte. Dans les deux cas
il y a promesse d’avenir et direction pour les pas : vers cette
terre là-bas !
Une responsabilité à l’échelle de l’histoire
Aussi l’élection représente une joie mais aussi
une épreuve. Joie d’être choisi, d’être
aimé, d’être libéré…Epreuve
de la singularité, du vis-à-vis avec l’Inconnu,
de la liberté. Certaines scènes des Hébreux
au désert en témoignent : « N’eut-il pas
mieux valu rester en Egypte, où il y avait toit et nourriture
? » (Exode 16,1-3) La réponse de Dieu à ce trop humain regret est donnée
au Sinaï, avec le sceau de l’élection que représente
la Torah : enseignement afin de vivre dans la liberté et
la fidélité. Cette Torah comporte à la fois
un récit qui raconte et une loi qui prescrit ou interdit.
L’un ne va pas sans l’autre, sous peine de mettre en péril
le fondement de l’alliance. C’est le récit transmis
de génération en génération qui porte
la mémoire et le sens de l’élection, c’est-à-dire
qui permet cette marche du passé vers l’avenir.
C’est la loi, sous forme de commandements positifs et négatifs,
sous formes de règles rituelles et religieuses mais également
éthiques, qui atteste ici et maintenant la réalité
de l’élection. Il s’agit pour le peuple élu
de témoigner concrètement à son Dieu qu’il
est son Dieu en vivant selon ses préceptes. Mais ce témoignage
n’a de sens qu’au milieu et au regard des nations, dans
la lignée d’un Abraham père de multitude , annoncé
comme bénédiction pour toutes les familles de la terre.
Dans le cadre du monothéisme, l’élection ne peut
se réduire au privilège donnant accès à
une terre promise, elle implique une responsabilité à
l’échelle de l’histoire et du monde.
La relecture chrétienne de l’élection
C’est tout l’enjeu posé par le prophétisme
biblique, qui trouvera son double accomplissement dans le Talmud
pour les juifs et dans l’Evangile pour les chrétiens.
Les prophètes, dans le contexte tragique de l’effondrement
politique d’Israël et de Juda sous les assauts des grandes
puissances voisines, verront en même temps la responsabilité
historique d’Israël, châtié pour ses fautes,
et l’espérance de Dieu à son égard : qu’il
soit « lumière des nations. » Alors le peuple
élu, toujours confirmé dans sa vocation, aura pour
tâche de signifier, par son attachement à la Torah
et son travail infini d’interprétation, la fidélité
inconditionnelle de Dieu, à travers exils, retour, malheurs,
espérance, persécutions, renaissance… Mais la relecture chrétienne de l’élection
se fera autour de Jésus de Nazareth, considéré
comme le Serviteur, l’Elu de Dieu, le Messie. Il élira
à son tour ses disciples par un choix libre et souverain,
et cette élection trouvera son accomplissement dans leur
foi personnelle en lui, leur communion fraternelle, et leur obéissance
à son enseignement d’amour. Mais s’y ajoute la
mission de proclamation dans le monde, car l’Eglise, nouvelle
assemblée élue de Dieu, développe un nouveau
rapport à l’universalité, en rupture avec le
judaïsme. Tout homme est appelé à croire en Dieu
et en son Messie. L’élection n’est plus liée
à l’appartenance à un peuple, mais à la
foi personnelle confessée et mise en actes.
Le sens fondamental de l’élection divine
Si l’on considère aujourd’hui la double élection
biblique, il est permis d’y voir une complémentarité
essentielle. Le peuple juif est voué pour l’éternité
à la tâche de transmettre et d’interpréter
la Torah, aussi bien par l’étude que par la pratique.
Les chrétiens, libérés pour leur part de cette
tâche, sont consacrés pour l’éternité
à la proclamation et au témoignage en actes du royaume
de Dieu. Mais le travail de l’un comme celui des autres se
fait au bénéfice de l’humanité toute entière.
Il s’agit dans les deux cas d’un devoir être pour
les autres, pour le monde, « lumière des nations ». C’est le sens fondamental de l’élection divine
: le peuple qui consacre sa vie et son histoire à transmettre
et interpréter la Torah veille sur les significations données
par Dieu à la vie de sa création ; l’Eglise appelée
à proclamer et témoigner de la réalité
du royaume de Dieu maintient vivante l’espérance d’un
amour vainqueur des forces de mort. Sans ces significations, sans
cette espérance, nul ne peut vivre une vie véritablement
humaine.
Il faut donc retenir de cette exploration biblique qu’il
n’y a pas d’élection sans choix libre et souverain
de Dieu, et sans la réponse humaine qui consiste à
accomplir en conscience sa vocation, ce pour quoi l’on est
fait et élu. L’élection n’est pas un privilège,
mais une responsabilité grave et magnifique. Etre choisi,
appelé, nommé, exige que l’on réponde
par un oui ou par un non, et que l’on en réponde par
la conscience et la fidélité. Mais cela ne peut se
faire qu’avec l’aide que Dieu nous apporte chaque jour
de notre vie.
Que vaut la théologie en politique ?
Maintenant ce qui vaut en théologie vaut-il en politique
? Si la liberté est au rendez-vous des élections citoyennes
comme de l’élection divine, l’arbitraire ne l’est
pas, car on élit un candidat à l’élection,
en fonction de son programme, de son positionnement politique, et
de ses capacités supposées. Pourtant l’expérience
montre que les élus diffèrent sensiblement, une fois
arrivés au pouvoir, des candidats qu’ils ont été.
Et là se retrouve finalement la double thématique
biblique de la fidélité et de la responsabilité. Les électeurs d’hier ne veillent-ils pas jalousement
à l’accomplissement des promesses électorales
par leur élus ? Cette vigilance est saine, tant qu’ils
ne se transforment pas en procurateurs impitoyables … Le Grand
Electeur Biblique, par son exemple, suggére une autre attitude
: il offre à ses élus, de manière concrète
et incessante, son aide et sa sollicitude, il résiste à
toutes les déceptions sans rompre son alliance mais en exigeant
toujours vérité, justice, miséricorde…Enfin
il ne désespère jamais de l’avenir !
Florence Taubmann
Réagissez sur le blog de l'Oratoire, faites profiter les autres de vos propres réflexions…
Si vous voulez remercier ou soutenir l'Oratoire : il est possible de faire un don en ligne…
|
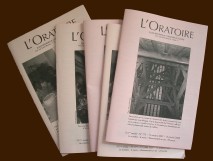

La mémoire et le sens de l’élection
(photo Gérard Deulin) |